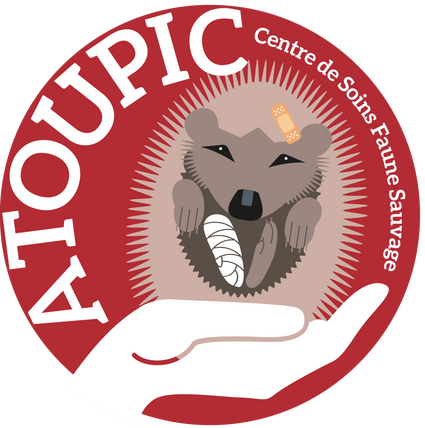DE - 56 à 48 MILLIONS D'ANNEES : UN ANCÊTRE DU HERISSON
Macrocranion tupaiodon, Museum de Messel, Allemagne
Mammifère insectivore éteint dont descend le hérisson, 16 cm de long, pattes postérieures nettement plus longues que les antérieures qui suggèrent qu'il sautait, à poils (les piquants des hérissons actuels sont des poils transformés). Le contenu de son estomac indique que l'animal avait mangé du poisson peu avant sa mort.
- 15 MILLIONS D'ANNEES : LES HERISSONS SOUS LEUR FORME ACTUELLE
Les hérissons, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont présents sur terre depuis 15 millions d'années, avant même les tigres à dents de sabre, les rhinocéros laineux et les mammouths ! On compte 16 espèces de hérissons dans le monde dont le hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) qui, comme son nom l'indique, habite l'Europe. C'est la seule espèce de hérissons présente dans toute la France (présence du hérisson d'Algérie dans les Pyrénées orientales).
Les 16 espèces de hérissons :
Le hérisson européen
Le hérisson oriental
Le hérisson des Balkans
Le hérisson de l'Amur
Le hérisson à ventre blanc
Le hérisson d'Algérie
Le hérisson de Somalie
Le hérisson d'Afrique du Sud
Le hérisson d'Égypte ou hérisson à grandes oreilles
Le hérisson indien à longues oreilles
Le hérisson daourien
Le hérisson de Hug
Le hérisson du désert ou hérisson du désert d'Éthiopie
Le hérisson indien
Le hérisson de Brandt
Le hérisson à ventre nu
Pour en savoir plus sur les diverses espèces : ici
Le Hérisson à ventre blanc vit en Afrique et n'hiberne pas. Contrairement aux autres espèces hérissons qui sont équipés de 5 orteils, il n'en a que 4.
LE HERISSON D'EUROPE
De la famille des Erinaceidés, les hérissons actuels ont assez peu évolué par rapport à leurs ancêtres d'il y a 15 millions d'années, dont ils ont conservé les piquants et la denture peu spécialisée. Leur évolution a été plutôt d'ordre écologique pour s'adapter au milieu dans lequel ils vivaient. Par exemple, les oreilles des hérissons du désert se sont allongées pour servir d'organes de thermorégulation afin de lutter contre la chaleur tandis que les différentes espèces de hérissons européennes (dont notre Hérisson d'Europe) ont acquis la faculté d'hiberner pour survivre aux hivers des zones tempérées froides.
Les piquants, au nombre de 5000 à 7000 environ, sont des poils modifiés au cours de l'évolution de l'espèce. Ils couvrent le sommet de la tête et le dos tandis que des poils raides recouvrent la tête, les membres et le ventre. Les piquants, à tour de rôle, se renouvellent ; la totalité l'est en 18 mois. Ils sont insérés par groupe de 3, entrecroisés et orientés dans un sens différent. Très solides et pratiquement incassables, ils remplissent 2 fonctions : se protéger des ennemis par un bouclier épineux et absorber les chocs (en cas de chute, par exemple) (b, 12 p.).
ANATOMIE
Une vision faible.
Bonne perception de la couleur jaune.
Un odorat très développé qui joue un rôle primordial dans son orientation (a, 13 p.) et la détection de ses proies, y compris sous terre (vers de terre).
Une ouie très développée qui lui permet d'entendre un ver de terre se déplacer 3 cm sous terre et de localiser une proie dans un tas de feuilles (h). Il perçoit aussi les ultrasons émis par les insectes.
Une queue courte de 2 à 3 cm
AUTRES :
36 dents pointues et une mâchoire puissante "lui permettant de croquer les coléoptères les plus carapaçonnés." (g)
Longueur adulte : 20 à 30 cm
Poids adulte : le poids moyen est de 1 kg mais le poids peut varier en fonction de l'âge et de la période de l'année, de 350 g à la sortie de l'hibernation à 2,2 kg pour un adulte mâle de plusieurs années, juste avant l'hibernation.
Mâle et femelle se ressemblent. Le mâle est légèrement plus grand et plus gros que la femelle.
Comme le laisse voir ce squelette de hérisson, "la taille réelle des membres est sous-estimée car on voit les hérissons plus souvent accroupis que debout, les longs poils des flancs les dissimulant" (c, 13 p.), donnant l'impression que le hérisson "glisse" au ras du sol.
En cas de danger, le hérisson peut fuir (mais la plupart de ses prédateurs sont plus rapides), crier, siffler, rarement mordre, ou dresser ses piquants et prendre la posture de la châtaigne, une boule épineuse impénétrable, légère, flexible et résistante, en contractant principalement le muscle orbiculaire qui fait le tour de son dos et "qui agit comme la languette de fermeture d'un sac poubelle" (f). Il peut rester en boule pendant des heures sans éprouver de fatigue. Il peut aussi se mettre en boule pour... descendre, se laissant chuter, par exemple, du haut d'un mur.
(d, 13 p.) Platel R, Meunier FJ, Ridet JM, Vieillot H. Zoologie des Cordés. ed ellipses, Paris, 1991, 222 p.
Membre antérieur à gauche, membre postérieur à droite.
Avec l'aimable autorisation du Dr Gaël Berthévas, auteur de cette photo
Le hérisson est un plantigrade, c'est-à-dire qu'il pose la plante au sol pour marcher. Ses 5 orteils terminés par de longues griffe lui permettent, avec ses pattes puissantes, de creuser un terrier ou sous un grillage, "de sillonner tous les types de reliefs et d'escalader des pentes très escarpées, voire des murs." (f)
A gauche, la femelle et à droite, le mâle
Avec l'aimable autorisation du Dr Gaël Berthévas, auteur de cette photo illustrée
L'appareil reproducteur du mâle et de la femelle est discret et, pour l'oeil non averti, pas si facile à voir d'autant plus que l'un et l'autre ont le même nombre de paires de mamelles, à savoir 5 (Le hérisson est un mammifère, la femelle allaitant ses petits). C'est la distance qui sépare le sexe à l'anus qui est le critère de distinction entre le mâle et la femelle : la vulve de la femelle est proche de l'anus tandis que le prépuce du mâle est nettement plus haut que l'anus (les testicules sont non visibles, dans l'abdomen) (e, 14 p.).
TEMPERAMENT
- vite indépendant (vers 2 mois)
- solitaire
- calme
- mais a son propre caractère
- ne vit pas en couple
- lent mais peut courir 30 à 40 m/min et
sprinter à 2 m/s en cas de danger ! (n, 40 p.)
ALIMENTATION
Longtemps rattaché à la grande famille (ordre) des insectivores comme les taupes et les musaraignes, le hérisson n'en fait plus partie depuis 2005 (ordre :Erinaceomorpha) et, du reste, il est omnivore avec une forte prédominance d'aliments d'origine animale qu'il détecte à l'ouie et à l'odorat, 2 organes très bien développés chez lui :
- En premier lieu, des invertébrés : une prédilection pour les vers de terre et escargots, limaces par nuit humide, une prédilection, par temps sec, pour les chenilles et coléoptères (carabes, scarabées, hannetons, gros bousiers, charançons, etc) mais aussi perce-oreilles, grillons, mille-pattes, libellules, parfois des araignées.
- En second lieu, des vertébrés : lézards, petits crapauds et grenouilles, oisillons tombés du nid, petits mammifères comme les souris.
Philippe Jourde explique que le hérisson, outre "un estomac et un système digestif en béton" (f), a développé une résistance lui autorisant "un régime varié, incluant des espèces toxiques, non consommées par la concurrence" (f) : "Pour indisposer un hérisson, il faudrait 100 mg de cantharidine, un poison violent issu des coléoptères méloïdés, alors que le héros de Terminator [Arnold Schwarzenegger] se retrouverait sur le flanc avec seulement 4 mg !" (f). D'autre part, selon le Dr Cornelis Neet (i), biologiste, un hérisson peut survivre à une dose d’arsenic pouvant tuer 25 personnes, soit une dose de 1,250 g/kg et supporte une dose de toxines tétaniques 7000 fois supérieure à celle pouvant tuer un humain, soit une dose de 17,5 mg/kg. Cependant, toujours selon le Dr Neet, le hérisson reste sensible aux pesticides et ceux-ci sont responsables de 26% des décès du hérisson (en 1990).
Il complète son régime par des oeufs, des champignons, des fruits mûrs tombés au sol et des graines. C'est à vrai dire un opportuniste ; il ne se fatigue pas à courir après ses proies, il se contente de celles qui passent à sa portée ! Il peut même manger des cadavres de rongeurs ou de serpents et fréquenter les poubelles à la recherche de restes alimentaires.
Le hérisson fait énormément de bruit en mangeant. Il mastique bruyamment, grogne, s'énerve, envoie de la terre à plusieurs mètres lorsqu'il gratte le sol, fouille parmi les feuilles, renifle bruyamment. Pour avaler ses proies, il peut découper le lombric en tronçons d'une dizaine de millimètres comme il peut croquer les coléoptères. Son appétit est solide : il peut ingérer plus de 80 coléoptères ou vers de terre en quelques heures ! Philippe Jourde rapporte "l'observation d'un individu dévorant goulûment 352 jeunes loches laiteuses en 1h30, le 9 octobre 2018 (juste avant d'entrer en hibernation), dans un potager de Charente-Maritime" (f). En effet, sa ration quotidienne tourne entre 60 et 90 g par nuit. 50 g lui suffiraient amplement au jour le jour mais il se constitue des réserves : ce supplément transformé en graisse lui fournit les calories indispensables à sa survie pendant son long sommeil hivernal (hibernation) d'autant qu'il ne constitue pas de réserves externes comme les écureuils ou les belettes, par exemple. Philippe Jourde indique même que certains individus "mangent trois fois plus, au point que certains individus gagnent 3 % de leurs poids par nuit (pour un humain de 70 kg, cela correspondrait à une augmentation quotidienne de 2,1 kg) ! (f)
En hiver, le hérisson peut sortir de son hibernation soit à cause d'un redoux hivernal répété (au-dessus de 10° C durable, il se réveille), soit parce qu'il est dérangé par les activités humaines et se trouve alors dans l'obligation de partir à la chasse pour refaire des réserves de graisse (son réveil et le réchauffement corporel lui coûtent de l'énergie). La raréfaction de ses proies en hiver le met en danger de mort, incapable de reconstituer des réserves. Si vous le voyez en journée ou si vous savez qu'un hérisson habite votre jardin, vous pouvez alors déposer chaque jour une coupelle de croquettes pour chat pendant l'hiver, et seulement pendant l'hiver : dès le début des beaux jours, cessez progressivement de l'alimenter car il doit repartir à la chasse pour conserver ses facultés à se nourrir seul.
Par été très chaud, les hérissons "faute de trouver de l'eau ou des proies, sont parfois obligés d'entrer en léthargie pour survivre. La mise à disposition d'une gamelle d'eau peut faire la différence entre la vie et la mort" (f).
SES PREDATEURS
C'est le grand cycle de la vie : le hérisson mange certains animaux et est mangé par d'autres. Si on prête au hérisson des prédateurs tels que le renard roux, la chouette hulotte, la buse variable, la fouine et même le sanglier, les 2 seuls prédateurs qui se nourrissent régulièrement du hérisson sont le blaireau et le hibou grand-duc, les autres ne le mangeant que rarement bien portant (jeunes hérissons encore maladroits dans la mise en boule), le plus souvent mort (par exemple, écrasé sur une route) ou blessé.
Ceux qui arrivent à bout de cette "bogue de châtaigne" ne sont pas nombreux : le hibou grand-duc et le blaireau qui le retournent sur le dos. Le blaireau glisse, par la fente bardée de piquants, les longues griffes d'une de ses pattes, dans le ventre du hérisson qui, blessé, desserre alors un peu sa boule de piquants. Le blaireau en profite et insère les griffes de sa 2ème patte, l'écarte et met le hérisson à plat, ventre à découvert (k). Le hibou grand duc utilise son bec puissant et ses serres pour désarmer le hérisson et enlève la peau du hérisson avant de le manger (on trouve des pelotes de piquants sur les sites habités par le hibou grand duc).
Le hibou grand duc
Le hérisson est, après le lapin de garenne, la 2ème proie de prédilection du hibou grand duc.
Si l'homme ne le consomme pas (exceptées quelques populations comme certains clans gitans), le hérisson semble avoir été, par le passé, consommé et utilisé dans la pharmacopée. Pline, né en 23 après J.C., l'évoque déjà dans son encyclopédique Histoire Naturelle : "On dit que la chair du hérisson est agréable" (j), et Françoise Burgaud (l), chargée de cours à Paris V René Descartes, rapporte qu'il a été mangé en temps de disette et pendant la seconde guerre mondiale.
HABITAT
MILIEUX NATURELS ET MILIEUX D'ADAPTATION
"Avec de tels atouts*, les hérissons ont pu conquérir l’Europe entière. Ils s’observent des semi-déserts andalous aux fjords de Norvège, des landes écossaises aux pentes volcaniques de Sicile" (g). En France, on le trouve jusqu'à 1200 m d'altitude, à la faveur d'une végétation de feuillus (il est rare dans les forêts de conifères), dans les bois, broussailles, parcs, jardins et dans les prairies humides (hélas, de moins en moins).
* Atouts : omnivore et opportuniste, adapté à tous les terrains, très bon nageur, système défensif efficace, stratégie de survie en conditions extrêmes (léthargie sur plusieurs semaines).
Très présent en campagne jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le hérisson trouvait des prairies pâturées pour y chasser, des haies, fourrés ou bosquets pour s'abriter ou se réfugier, mais aussi des petits vergers et des petites parcelles de cultures diversifiées... bref, c'était le jardin d'Eden du hérisson !
Mais avec l'agriculture intensive (plus de terrains de chasse), le démembrement (plus d'abris et refuges) et l'appauvrissement, la destructuration et la contamination des sols (empoisonnement de ses proies) qui anéantissent le monde vivant, le hérisson, en France, s'est replié sur les zones péri-urbaines ou urbaines
(jardins privés, parcs et jardins publics) où il est désormais 9 fois plus présent qu'en zone rurale (étude dans le nord-est de la France) (m). S'il y trouve des haies, des points d'eau, des tas de compost (un vrai garde-manger pour lui) et des croquettes pour chat, il est aussi exposé à d'autres menaces (ici) "mais globalement, les proies sont présentes, les potentialités de gîtes nombreuses et les humains rares passé le journal de 20 heures." (g). A noter d'ailleurs que le hérisson "des villes" s'avère un peu paresseux (car la nourriture est plus disponible) et hiverne un peu moins longtemps que le hérisson "des champs" (p).
D'où l'importance de gérer son propre jardin comme une terre d'asile ou une arche de Noë pour le hérisson et, plus globalement, pour le monde vivant. D'ailleurs, le hérisson est considéré être, en ville, une espèce "parapluie", c’est-à-dire que sa simple présence garantit celle de nombreuses autres espèces, témoin essentiel de la biodiversité urbaine. Protéger le hérisson, c'est donc protéger de nombreuses autres espèces (p).
Quant aux hérissons qui subsistent dans les milieux cultivés, exception faites des régions bocagères à élevage, ils sont cantonnés aux bords de routes et les voies ferrées bordés d'herbes et de buissons mais sont peu à peu exterminés, victimes des collisions routières, des épandages, ou des tracteurs et des travaux mécaniques qui les écrasent, les coupent ou broyent mortellement.
DOMAINE VITAL
hérisson transportant dans sa gueule des matériaux de construction pour son abri/nid.
Construction d'un nid, solide et sécurisé, adapté à l'hibernation ou la reproduction.
HIBERNATION
Période d'hibernation : d'octobre à mars/avril
Le hérisson n'a du poil que sur ses pattes, sur le visage et sur le ventre. Toute la surface recouverte de piquants, c'est-à-dire la plus grande du corps, est sans poils. Ce n'est donc pas le pelage qui le protège du froid. Il ne migre pas non plus vers des régions plus chaudes comme le bison ou l'hirondelle, il ne pratique pas davantage le réchauffement en groupe comme les manchots et son corps ne fabrique pas de protéines antigel comme le hareng ou certains coléoptères (ténébrions par ex.)... non, rien de tout cela : il s'enrobe dans une couche thermique de graisse qui l'isole du froid et il abaisse la consommation énergétique de ses fonctions corporelles au plus bas, en hibernant.
Ainsi, à l'automne, son métabolisme ralentit déjà pour optimiser la mise en réserve des graisses et des protéines à venir (n, 52 p.). Le hérisson se gave, certains individus prenant 3% de leur poids par nuit, mangeant à peu près tout ce qui passe à sa porté, "y compris des proies et cuirassées, comme des écrevisses de Louisiane, ou de puissants carabes, dont le goût révulse la plupart des autres prédateurs" précise Philippe Jourde (f). Les quantités ingurgitées en prévision de l'hibernation sont impressionnantes comme en témoigne "l'observation d'un individu dévorant goulûment 352 jeunes loches laiteuses en 1h30, le 9 octobre 2018 [un peu avant d'entrer en hibernation], dans un potager de Charente-Maritime" (f).
"Quand la nourriture du hérisson se fait rare et sous un seuil de température, qui varie selon les régions entre 5 à 7°C la nuit, le hérisson se réfugie dans un des nids qu’il a préalablement construits.
Se déroule alors un phénomène extraordinaire : l’hibernation. En l’espace de quelques heures, l’animal va profondément modifier ses fonctions vitales. Sa température interne s’abaisse de 35 à 4°C ce qui correspond au réglage optimal de votre réfrigérateur. Le rythme cardiaque, habituellement de 150 à 280 pulsations par minutes, chute à 5 battements par minute Les phases de respiration sont entrecoupées d’apnées pouvant durer jusqu’à deux heures ; les cachalots, pourtant 100 000 fois plus gros, ne font pas mieux. Pour éviter la déperdition d’eau, la fonction rénale est réduite. Le métabolisme du glucose est minimal pour réduire la consommation d’énergie. Le hérisson met donc tout son corps au ralenti. Il entre dans un état comateux, proche de la mort et consomme dès lors en 120 jours, l’énergie que lui coûterait une unique journée d’activité printanière ! La température idéale d’hibernation du hérisson se situe à 4°C. Au-dessus et en-dessous de ce seuil, la consommation de graisse s’accroît. Le hérisson s’abrite donc dans un nid de feuilles, dont la position et l’isolation permettent le maintien de conditions relativement constantes.
Mais notre Belle au bois dormant ne sommeille pas en continu. Elle se réveille brièvement tous les 7 à 11 jours [pour éliminer l'acidose accumulé dans l'organisme] et plus durablement si la température extérieure se radoucit et permet de partir en chasse. Si, au contraire, une vague de froid survient, un système de sauvegarde relance l’activité de l’animal pour éviter qu’il ne se transforme en marron glacé. Il n’est pas rare alors que le hérisson déserte son gîte au profit d’un abri mieux adapté pour continuer son hibernation" (f).
On distingue 2 types de graisses : la graisse blanche, au niveau abdominal, où sont stockés les acides gras pour tout l'hiver et la graisse brune, au niveau des épaules (appelée ainsi car le tissu adipeux est brun), utilisée à chaque réveil spontané et qui se reconstitue en totalité à partir de la graisse blanche entre chaque réveil périodique spontané (tous les 7-11 jours). Elle est plus rapidement mobilisable que la graisse blanche et produit rapidement de la chaleur, faisant monter en 3 heures la température corporelle de 5° C à 35 ° C (n, 55 p.).
A la fin de l'hibernation, le hérisson perd 30 % à 40 % de son poids sans dommages, ses plus grosses dépenses étant dues aux réveils spontanés tous les 7 à 11 jours, la production et montée en chaleur demandant beaucoup d'énergie (n, 30 p.). Mais les hivers doux de ces dernières années provoquent des réveils intempestifs quand la température extérieure tourne autour de 10° C (ils n'ont rien à voir avec les réveils périodiques spontanés) et prolongent plus loin dans l'hiver les activités d'entretien au jardin qui dérangent et réveillent des hérissons en hibernation. En est-on toujours à 30 ou 40 % de poids perdus au cours de l'hibernation ? Ou est-on au-dessus ? Si oui, avec quelle incidence sur la mortalité des hérissons ?
En période caniculaire, le hérisson d'Europe applique une stratégie suivie par nombre d'animaux vivant dans les conditions arides des pays chauds (dont les hérissons d'Afrique) : il entre en estivation, c'est-à-dire en dormance, mais dans un sommeil moins profond que celui de l'hibernation (o, 1425 p.) avec un métabolisme en hypoactivité pour limiter les pertes d'eau et réserver la dépense énergétique au fonctionnement a minima des fonctions vitales.
Le saviez-vous ? L'ours hiverne : sa température diminue mais dans des proportions sans commune mesure avec l'hibernation, ses fonctions vitales sont maintenues au même niveau qu'en période d'activité, il somnole dans un sommeil plus léger qu'en hibernation, l'activité cérébrale et la vigilance sont réactives malgré la torpeur. Du reste, la femelle peut donner naissance à des petits et les allaiter en hiver. Mais l'ours peut aussi hiberner quand la température descend au-dessous de 6°C pendant 2 jours.
REPRODUCTION ET PETITS
UN SOLITAIRE AUX BONNES MANIERES
Bien que solitaire, le hérisson n'est pas seul sur son territoire. Il le partage, à bonne distance, avec d'autres hérissons qui vont et viennent. Aussi, dès la fin de l'hibernation, le mâle se met en quête d'une femelle pour se reproduire, pouvant marcher plusieurs kilomètres par nuit. Il ne se pare pas de couleurs attrayantes, il ne fait pas de vocalises sans fin pour attirer une partenaire et il ne livre pas de combat à mort contre un autre mâle pour les beaux yeux de la belle. Non, il fait dans la discrétion et courtoisie : quand il trouve une partenaire, "il l’accompagne dans ses déplacements, lui fait la cour, parfois des jours durant, parade, s’approche et tourne autour d’elle. Si elle n’est pas disposée, elle se carapate, le charge, ou adopte une posture de défense, piquants hérissés. Cela refroidit immédiatement les ardeurs d’un Don Juan importun. Si elle est consentante, elle adopte une posture cambrée, couche les piquants de son dos. Le mâle peut alors la monter avec précaution. Les deux amants peuvent rester quelques jours ensemble et s’accoupler à plusieurs reprises ou se séparer et espérer de nouvelles rencontres". (h)
REPRODUCTION
- Maturité sexuelle : 11 mois
- Saison des amours : avril à septembre
- Parade du mâle : sobre, pas exubérante
- Gestation : 31-35 jours
- Nombre de petits par portée : 2 à 7
- Nombre de mises à bas/saison : 1 ou 2
- Poids de naissance : 10 à 25 g
- Durée d'allaitement : 4 semaines
NID DE REPRODUCTION, MISE A BAS ET ELEVAGE DES PETITS : L'AFFAIRE EXCLUSIVE DE LA FEMELLE
"Les mâles ne s’occupent pas des jeunes. Ils vagabondent pour disséminer leurs gènes autant que possible". (h)
La femelle, après une gestation de 35 jours environ, met bas, en 1 ou 2 heures, de 2 à 7 bébés hérissons (mais la moyenne est de 3 à 5), dans un nid douillet, plus grand que celui d'hiver, abrité et discret et qu'elle a construit pour l'occasion quatre à cinq jours auparavant. Elle peut faire un 2ème nid si elle a été dérangée avec ses petits et les déplacera en les portant entre ses dents.
- Le bébé hérissons naît complètement nu, sans fourrure, sans piquants (et même recouvert d'un opercule pour ne pas blesser sa mère), pesant 10 à 25 g, aveugle à la naissance, telle une "petite larve rose" (h) sans défense... et pourtant, il peut être autonome au bout de 40 jours :
- 3 heures après la naissance : le bébé est recouvert de piquants blancs et mous.
- Dès la 36ème heures, des piquants bruns à bout blanc font leur apparition.
- A 4 semaines, le jeune hérisson sera recouvert exclusivement de piquants bruns.
- Au 11ème jour : le bébé hérisson se met en boule.
- Au 15ème jour : le hérisson acquiert le geste d'autolubrification, s'enduisant de bave (video), après avoir léché un objet ou une substance. Sa raison fait l'objet de plusieurs hypothèses, n'apportant pas d'explication claire et unanime à ce geste.
- La 2ème semaine : la fourrure apparaît et ira s'intensifiant.
- A 2 semaines : les yeux s'ouvrent.
- Dès la 3ème semaine : les dents apparaissent. La dentition est définitive vers 4 mois.
- A 4 semaine : il pèse environ 120 à 170 g et tente sa première sortie.
- A 5 ou 6 semaines : il pèse 200 à 300 g. Il peut déjà prendre son indépendance si sa mère tente la seconde portée de la saison. Mais si elle préfère garantir l'avenir des jeunes de sa première portée (20 % des bébés ne survivront pas : parasitisme, lait insuffisant pour allaiter une grande portée, etc ), elle n'aura qu'une seule portée et allaitera ses petits jusqu'à 8-10 semaines.
A noter :
- Dans les premiers jours de la portée, si la femelle est dérangée, elle peut manger ses petits. D'où l'importance de veiller à ne pas déranger une maman et ses petits.
- Si les juvéniles (au-delà des premiers jours) poussent leurs cris aigus, la femelle rejoindra sa portée et la défendra activement.
- Le lait de la femelle est riche en protéines et en matières grasses mais pauvre en lactose (alors que le lait de vache est riche en lactose : il est donc indigeste pour les hérissons).
- Un mois après la séparation mère-petits, la mère ne les reconnaît plus si elle les croise !
source : lc000010.jpg (550×367) (servimg.com)
Bébé hérisson vient juste de naître
Quelques heures après la naissance
A environ 3 semaines, dans les mains d'Anne Dupuy